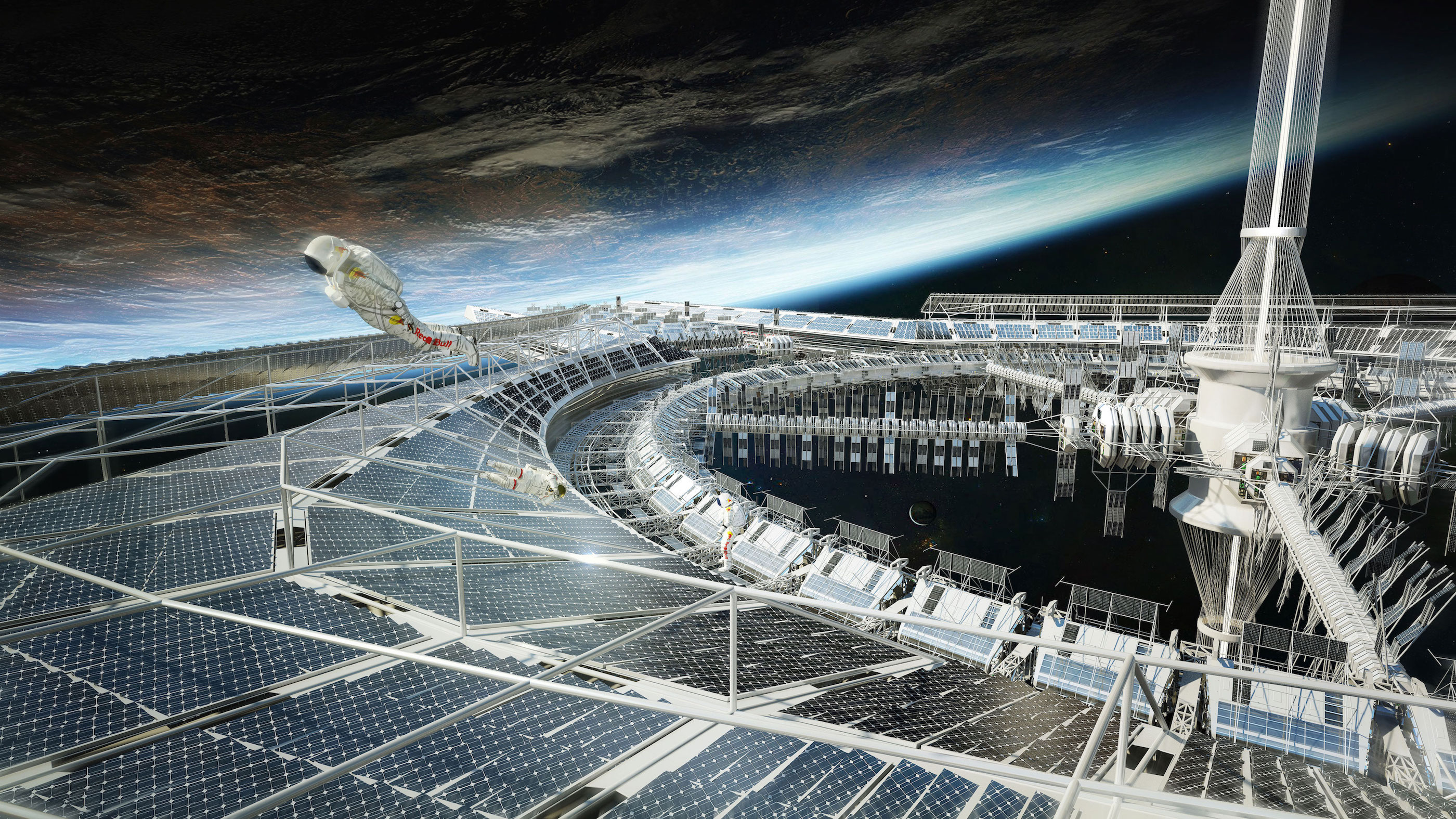La création est affaire de réinterprétations
François Chatillon est un homme tiraillé par les paradoxes : d’un côté, création et conservation, de l’autre, patrimoine et contemporanéité. Si son métier réclame de lui un regard objectif et si la restauration, telle qu’elle se pratique, impartiale, en Catalogne, le fascine, il revendique, en tant qu’Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH), une œuvre d’auteur ou du moins d’interprète. Dans son discours comme dans sa pratique, François Chatillon fait montre d’agilité. Le goût de la provocation l’oriente parfois sur les chemins de la contradiction. Ainsi, s’il dit détester le mot patrimoine, il ne cesse – comment pourrait-il en être autrement ? – de l’utiliser. Cette attitude trahit à bien des égards une volonté de bousculer les conventions, y compris les plus politiques. Le verbe a beau être haut, l’exercice de sa profession reste dans la mesure. Le crible du doute le conduit à interroger jusqu’à l’évidence tous les partis pris possibles. Sa vie professionnelle elle-même est passée par cette remise en question et, coup d’éclat, à 40 ans, il intégrait Chaillot au point de bouleverser la nature de ses réflexes et de devenir ACMH. François Chatillon se présente comme un homme de nuances. À l’heure du tweet tranché et de l’avis catégorique, cette hygiène morale est revigorante.
L'entretien qui suit, conduit par le journaliste Jean-Philippe Hugron, est extrait du hors-série L'Architecture d'Aujourd'hui "Compositions", consacré au travail de l'agence Chatillon Architectes. Cet ouvrage est disponible sur notre boutique en ligne.
L’Architecture d’Aujourd’hui : Comment présenteriez-vous votre agence?
François Chatillon : D’abord et avant tout, mon agence est composée de collaborateurs formidables: architectes, historiens et même tailleur de pierre. D’un point de vue statistique, c’est aussi 30-35 ans de moyenne d’âge, 65% de femmes. La société change, notre agence avec. C’est aussi une équipe cosmopolite. Ce brassage n’a pas été pensé mais il fait l’identité naturelle de cette société. Personne ne vient travailler ici par hasard et tout le monde fait montre d’un intérêt sinon d’une passion pour le patrimoine. S’il fallait en revanche évoquer une évolution, c’est celle qu’a impulsée, ces dernières années, mon fils, Simon, pour le développement de l’agence, de ses projets et de son image. Il apporte sa vision de l’architecture et affirme notre capacité à concevoir une architecture de notre temps pour que l’agence reste un outil en phase avec son époque. Enfin, s’il fallait retenir une spécificité, j’évoquerais notre approche de la complexité comme actuellement sur les bords de la mer Rouge, où nous menons une expertise patrimoniale en vue de la restauration de villages anciens dans le but de concilier développement touristique et standards de l’Unesco.
AA : Votre parcours est singulier. Pourquoi avoir décidé de faire Chaillot à 40 ans ?
FC : C’était un jour où je concevais des collèges… j’ai eu envie d’aller ailleurs. Sur le conseil d’un ami, je me suis inscrit à Chaillot sans avoir l’intention de devenir le nouvel évêque de la préservation. Si je m’intéresse à la conservation, celle-ci ne doit pas être sans but. Une fois sur les bancs de l’école, c’était épouvantable. Imaginez, à 40 ans, découvrir que je n’ai pas le niveau technique de mes confrères… Au premier exercice: 5/20. Il y a de quoi s’interroger. Les enseignants ont su se montrer pédagogues. Chaillot a donc été pour moi un temps de questionnement de ma pratique architecturale à travers une formation intellectuelle exceptionnelle, qui permet d’envisager différemment le rapport de la création contemporaine avec le patrimoine.
AA : Devenir peu après ACMH au mitan d’une carrière n’est sans doute pas sans conséquences. Comment avez-vous vécu ce basculement ?
FC : En tant qu’ACMH, je ne subis désormais plus la commande comme avant. Il y a certes des exigences mais j’ai aussi une liberté de parole que je n’avais pas autrefois. J’appréhende la contrainte de l’existant comme une formidable opportunité de me dérober face à la norme et même à la bien-pensance ; le travail dans l’existant ne peut pas se soumettre à l’arbitraire exogène de l’architecture. Il faut bricoler. De fait, je me sens bien plus libre aujourd’hui que quand j’avais 30 ou 40 ans. Un exercice plus traditionnel de l’architecture se frotte sans cesse à ce réflexe, qui empêche le meilleur pour éviter le pire. Aujourd’hui, je rentre dans l’histoire des autres, dans des objets qui ont une valeur artistique, des objets polis, pensés, voulus, éminemment désirés.
AA : Seriez-vous enclin à dire que le patrimoine est un Eldorado?
FC : Dieu a été remplacé par le patrimoine. L’ancien, le vieux, fait l’objet d’une dévotion sacrée. Regardez Notre-Dame de Paris. À mes yeux, le patrimoine n’est pas ce lingot d’or qu’on imagine, c’est un actif qui circule, qui évolue. Plus les gens se raccrochent au patrimoine, moins ils croient en l’avenir. Ce dogme, qui réclame la conservation de tout ce qui est vieux, est un réflexe faignant. Tout garder est bien moins fatigant et fige le patrimoine par référence à un état passé. Prenons le cas de l’appartement du Corbusier. Faut-il restaurer celui de 1936 ou celui de 1965 ? Je réponds toujours par la provocation et affirme que l’état de référence est bel et bien celui du projet, projet collectif dont l’architecte est le chef d’orchestre car c’est la société qui projette sa vision du passé sur l’usage qu’elle souhaite en faire.

AA : Quid de Notre-Dame de Paris ?
FC : Comme tout le monde, j’ai été ému par l’incendie. Même s’il faut relativiser : personne n’est mort. Ce qui m’a manqué pour Notre-Dame de Paris est le débat. Le temps de l’instant médiatique et de l’actualité nous a obligés à choisir un camp dans l’immédiateté de l’événement. Faire du neuf ou reconstruire à l’identique : ces réflexes nous font passer à côté de l’essence même du projet.
AA : Comment définiriez-vous cette notion de projet ?
FC : Conserver n’est pas un acte créatif solitaire qui surgit d’une page blanche. C’est un projet éclairé par la connaissance. Pour ce faire, nous réalisons des enquêtes afin de répondre à des questions simples : Qu’a voulu l’auteur ? Comment l’a-t-il fait ? Pourquoi l’a-t-il réalisé ainsi? Que voulait celui qui a transformé l’ensemble? … Nous donnons de la sorte, à une construction, une valeur historique, une valeur artistique, une valeur documentaire et même une valeur d’usage. Prenons l’exemple de la Maison du Peuple de Clichy. Au-delà de l’architecture de Beaudouin, Lods, Bodiansky et Prouvé, il y a ici une histoire sociale liée à l’apport culturel du communisme dans les banlieues sur laquelle on ne peut absolument pas s’asseoir, quelles que soient ses convictions politiques. C’est la valeur d’usage qui prime ici sur toute autre considération. Y faire un hôtel de luxe ne fait absolument pas sens. Pire, j’y vois la négation du passé. Il y a enfin des valeurs contextuelles, qui appellent à ne pas dépareiller dans un environnement bâti et à ne pas penser l’intervention de trop. Cela étant, mon rôle n’est pas de donner des autorisations, de distribuer les bons points mais bel et bien d’essayer de comprendre ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas. Je suis également dans un accompagnement technique pour préciser chacune de mes positions. Cette manière de penser le projet me place en opposition au réflexe idiot qui consiste à croire que l’âge fait l’intérêt. Nous sommes, je pense, trop influencés par l’Italie et la sacralisation de la matière. Je me montre alors toujours prêt à engager des débats périlleux et, de fait, je me retrouve sans cesse menacé par la controverse, mais un projet se construit, y compris dans un cadre patrimonial, pierre après pierre. La Cité de Refuge, sur laquelle je suis intervenu avec mon ami François Gruson, a fait l’objet de longues discussions afin de dépasser certains dogmes car dans le domaine de la conservation tout ne doit pas être matériel.

AA : Aimeriez-vous voir reconstruire la tour manquante de la basilique SaintDenis, les Tuileries ou encore le château de SaintCloud ?
FC : Reconstruire signifie aussi démolir. Ce qui m’intéresse est ce qui est là. Certes, j’aimerais rebâtir les maisons de Ledoux, m’y promener… mais en 3D. Intellectuellement, j’y trouverais un plaisir. Dans la réalité, je n’y verrais que la liberté d’un possédant. Je ne suis pas plus dans l’idéal de reconstitution et ne pense mon métier que dans la continuité du passé. Alors, le retour en arrière : non.
AA : Comment s’est développée votre sensibilité au patrimoine ?
FC : J’ai fait mes études à l’ENSA Grenoble pendant quatre ans pour les terminer à l’ENSA Paris-Belleville. Je n’avais pas l’intention de rester à Paris et je suis retourné dans mon village natal, à Ferney-Voltaire. J’y ai créé une agence, construit des garages, des villas, des immeubles. Là, avec ma femme, Eva, nous nous sommes retrouvés embarqués par un ami metteur en scène, Hervé Loichemol, dans une aventure intellectuelle autour de l’héritage des Lumières avec la création d’un centre culturel de rencontres au château de Voltaire, fraîchement acquis par l’État. Je me suis alors trouvé confronté pour la première fois, en tant qu’architecte, à la question patrimoniale. Au même moment se posait la question de monter de façon contemporaine des pièces de Goldoni. J’estime à bien des égards qu’assister à cet exercice fut ma première classe.
AA : Vous sentez-vous proche d’une école de pensée?
FC : Je me sens proche de la Catalogne et de son école de restauration objective. Antoni Gonzalez et ses travaux sur le Palais Güell sont pour moi représentatifs d’un rapport objectif à l’architecture dans l’intention de la valoriser. Il a dirigé les services des Monuments Historiques dans les années 2000 et est l’auteur de nombreux ouvrages qui mériteraient d’être traduits et enseignés en France. Je pense également, inévitablement, aux projets de Victor López Cotelo et en particulier à celui de la Casa de las Conchas à Salamanque. Son approche est d’une finesse absolue. Quant à Carlo Scarpa, il est le maître incontesté.
AA : Vos études ont-elles été marquées par certaines personnalités ?
FC : Les études d’architecture sont violentes ; on humilie les étudiants sans jamais leur donner les clefs de compréhension. Il faut une personnalité terrible, sans quoi on se retrouve vite brisé. Heureusement, Nicolas Ragno et ses premiers cours ont aussi été marquants: le premier d’entre eux portait sur la feuille de papier, le deuxième sur les crayons. Cela paraissait hors de propos mais tout était parfaitement pensé : le grammage, la manière de coller, les mines grasses, sèches… Il nous enseignait ce rapport au geste qu’on retrouve chez les compagnons. Il faut savoir utiliser la feuille de papier, domestiquer la matière pour ne pas refaire ou recommencer. C’est lui qui, un jour, avait invité Maurice Culot à l’atelier. Il nous avait fait faire le relevé d’une fenêtre grenobloise au Graphos qui nous avait pris des journées entières mais dont je me souviens encore aujourd’hui. Arrivé à Paris, tout le monde se précipitait chez UNO. J’y suis resté quinze jours. Je n’ai pas tenu. Puis, par chance, j’ai croisé Daniel Bernstein, coauteur de La maçonnerie sans fard, encore aujourd’hui un ouvrage de référence pour moi, avec lequel nous sommes rentrés dans le détail de l’architecture.

AA : Que pensez-vous de l’enseignement aujourd’hui ?
FC : Faisons en sorte que Chaillot soit dans toutes les écoles. Le débat intellectuel sur les objets, leur sens et leur valeur n’est pas infusé dans les ENSA comme il l’est à Chaillot. L’architecture est pourtant une question interdisciplinaire et l’enseignement manque, à bien des égards, de curiosité. Il faudrait non pas passer des heures retranchés derrière un écran qui médiatise l’architecture mais des journées entières avec des compagnons. Par exemple, la stéréotomie est un exercice mental de géométrie descriptive qui fait prendre conscience de l’espace. Combien de fois les logiciels se révèlent impuissants quand les appareilleurs, eux, peuvent tout imaginer ? Le Corbusier avait cette culture de la pierre, ses carnets sont pleins de stéréotomie. Les bâtiments des années 1960 ou 1970 ont encore cette finesse de conception: Henry Bernard ou Bernard Zehrfuss avaient cette double formation, classique –«Beaux-Arts», diront d’autres– et moderne.
AA : De quelle manière la révolution numérique s’adapte-t-elle, entre vos mains, à la question patrimoniale?
FC : Si j’admire le travail des compagnons, je dois préciser aussi que je m’intéresse depuis toujours aux possibilités que proposent les nouvelles technologies. En 1993, je commençais à faire de la 3D sur un Hewlett-Packard. Aujourd’hui, toutes les images de nos projets mais aussi le BIM sont traités en interne. J’y vois le moyen de maîtriser notre action. Les outils numériques nous permettent en effet de travailler efficacement dans nos relevés et dans nos analyses. Nous identifions ainsi les zones d’incompréhension et de doutes souvent liées à l’inaccessibilité d’une structure, par exemple. C’est notre façon de définir ces zones à risque. Pour ce faire, notre méthode est simple: nous travaillons d’abord à partir des plans d’archives, sur lesquels nous superposons les nuages de points des lasers 3D, arrivent ensuite les plans de géomètre. Si notre nuage correspond aux archives, celles-ci deviennent notre référence. Si, à cause de tassements ou de transformations tardives, le nuage correspond davantage aux plans de géomètre, ce sont ces derniers qui nous servent de référence. Cette approche, que nous appelons en interne « analyse patrimoniale numérique », nécessite beaucoup de travail mais est particulièrement payante à la fin. Le BIM est utile à la compréhension d’un bâtiment mais aussi à la manière dont nous intervenons.
AA : La récente évolution de la maîtrise d’œuvre montre que ses clients la détournent souvent du chantier en ne lui accordant que des missions partielles. La même chose est-elle possible pour un ACMH ?
FC : Les architectes démissionnent du chantier. Autrefois, un architecte prenait une entreprise. Aujourd’hui, c’est l’inverse. J’y vois l’origine d’un mal. À mon sens, le métier d’architecte s’intéresse à deux dimensions: la dimension intellectuelle, partagée avec le client, et la dimension matérielle avec l’entreprise. Le patrimoine implique de travailler beaucoup plus en profondeur. Pour maîtriser la construction, nous dessinons en conséquence de très nombreux détails «à la suisse», proximité lémanique oblige. C’est une histoire de foi. Il est également impératif pour des questions de responsabilité de s’intéresser au droit. C’est à ces conditions que nous pouvons conserver le pouvoir nécessaire à la maîtrise du projet.

AA : Quelle est la place d’un ACMH aujourd’hui sur la scène architecturale?
FC : Du fait de ma position d’ACMH, trop de maîtres d’ouvrage m’excluent du champ de la création contemporaine et cherchent dès lors des associations de force, neuf fois sur dix contre-productives. Par ma formation et ma culture, lorsque je m’attaque à un monument historique je sais que je ne sais rien, que je dois tout apprendre de lui et que le projet naîtra de cet apprentissage. Malheureusement, la formation de nombreux architectes en France les empêche d’emprunter ce chemin d’humilité et les pousse à chercher à faire le vide dans le monument pour matérialiser leur soif de reconnaissance. Pour ma part, je cherche le plein des autres : c’est l’enseignement de Chaillot mais aussi du théâtre.
AA : Avant de conclure, comment ne pas évoquer le Grand Palais. Que souhaiteriez-vous dire à ce sujet?
FC : Je crois que l’époque n’est plus aux grands gestes architecturaux, surtout lorsqu’il s’agit d’un bâtiment déjà extraordinaire comme le Grand Palais. Nous devons trouver la voie de la sobriété sans pour autant renoncer aux ambitions artistiques et culturelles. Cette situation interroge aussi bien la création contemporaine que la conservation des monuments historiques et les crises que nous traversons en précipitent la mise en œuvre. J’espère que le projet que nous développons pour le Grand Palais permettra de démontrer la modernité de cette démarche.
AA : Le mot de la fin ?
FC : Pour ce qui est de mon métier d’architecte, préoccupé du monde tel qu’il nous parvient, et du rapport que j’entretiens avec le passé, je me réfère au théâtre et à la musique, plus précisément à l’opéra italien, si bien servi par mon ami Leonardo García Alarcón, ce théâtre chanté dont nous possédons souvent peu d’éléments : un texte, une ligne mélodique, une base chiffrée, des mesures vides d’improvisation. Tout le reste n’est que travail d’interprétation… Plus largement, le mot de la fin est précisément qu’il n’y a pas de fin. La fin de notre vie n’est pas la fin du monde. Je suis en accord total avec la vision du philosophe Emanuele Coccia, qui place nos vies et nos actions dans une continuité entre ce qui a été et ce qui sera. Je me méfie de ceux qui prétendent détenir la vérité, fanatiques de tout poil ou prophètes de la fin des temps. Je regarde le monde avec l’optimisme amusé d’un voltairien qui aime à cultiver son jardin.